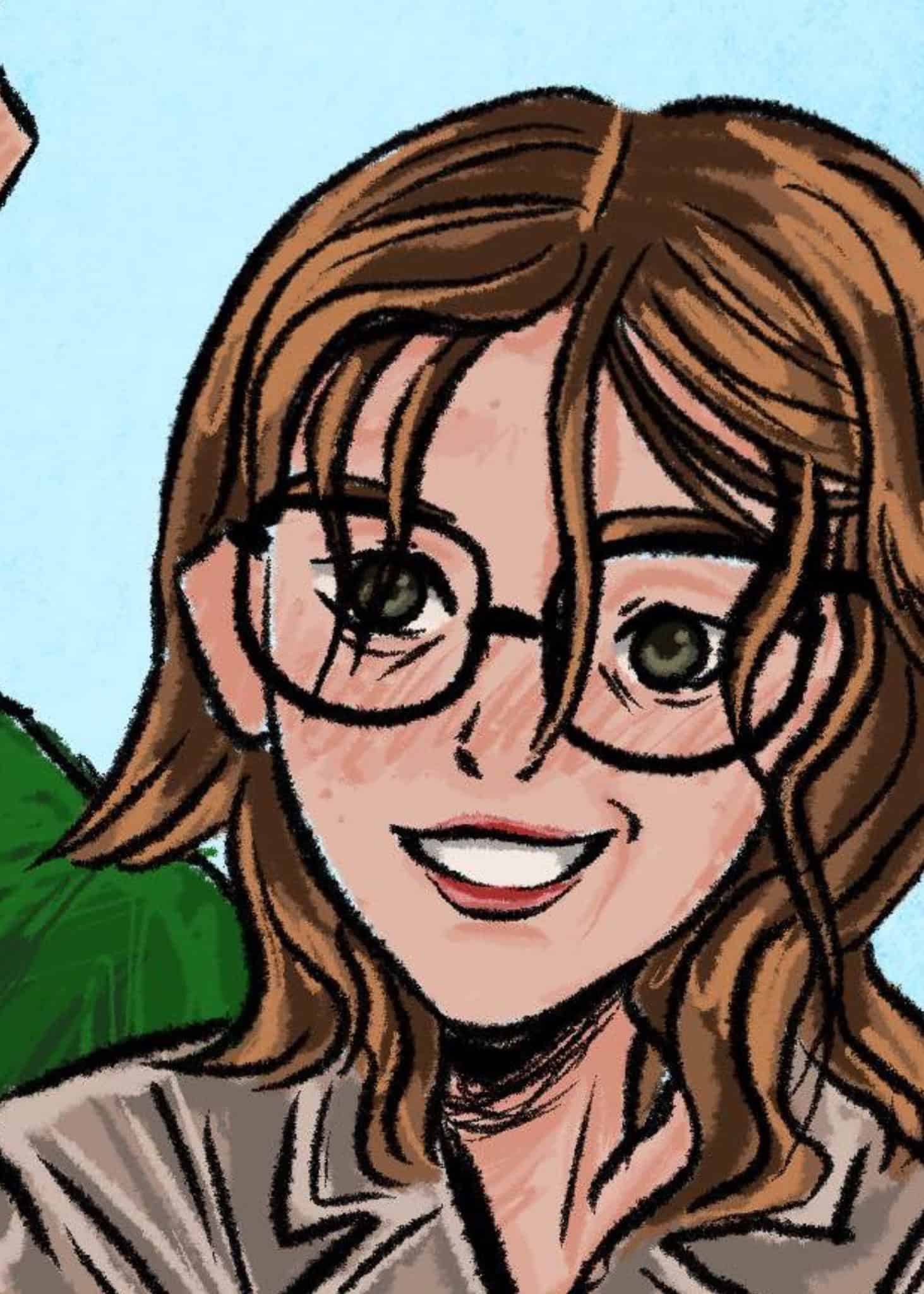Nos campagnes ont été vidées de leurs services publics, mais aussi d’une partie de leur jeunesse. Ceux qui restent voient trop souvent leur voix marginalisée dans la société. Pourtant, loin d’être des territoires en déshérence, les campagnes sont des espaces vivants qui méritent d’être mieux compris et défendus.
On a tous entendu parler de la « diagonale du vide » en cours de géographie : ce vaste espace qui traverse la France des Ardennes aux Landes en passant par la région Centre. Une diagonale supposément vide, désertée, loin de toute civilisation. « Rien à voir, circulez. »
Rassurez-vous, camarades ruraux qui lisez ces lignes : ce concept n’est plus enseigné dans les écoles françaises ! En plus d’être inexact, il porte un regard purement urbano-centré sur nos territoires, réduisant nos univers à… du vide. Parler de territoire à faible densité de population (moins de 30 habitants par km²) est non seulement plus factuel, mais aussi plus respectueux de la diversité de nos espaces. Car non, la ruralité n’est ni un territoire uniforme ni un monde figé. 40 % du territoire français est concerné, et près de 4 millions d’habitants y vivent.
Une fierté rurale à revendiquer
Nos régions ont leurs histoires, leurs traditions, leurs spécificités. Il ne s’agit pas de les opposer aux villes, mais de les revendiquer pour ce qu’elles sont : des territoires vivants, dynamiques, et qui méritent qu’on les valorise autrement que par des clichés.
Ces dernières années, les campagnes de marketing territorial ont tenté de revaloriser ces espaces, cherchant à attirer de nouveaux habitants. Finie l’image misérabiliste des campagnes désertées ; place à la carte postale idyllique d’une vie au ralenti, rythmée par le chant des oiseaux et la convivialité des voisins. Mais cette vision romancée est tout aussi fausse et dépolitisée que la précédente. Elle masque les réalités vécues par les habitants et perpétue une confiscation du récit rural. Comme l’écrivait Pierre Bourdieu, on réduit alors les ruraux à une « classe objet », privée de sa propre parole et de sa propre définition.
Un combat pour l’égalité territoriale
Nous, jeunes ruraux, devons faire entendre nos voix. Nous aimons nos régions, mais nous connaissons aussi leurs difficultés : chômage, éloignement des services publics, déserts médicaux et psychologiques, suicides agricoles, isolement, manque de mobilité… Ces réalités nécessitent des politiques publiques ambitieuses et de long terme. Les habitants de ces territoires contribuent autant que les autres à la richesse nationale : il est donc légitime qu’ils bénéficient de services publics de qualité et de proximité, au même titre que les citadins.
Nos territoires ne sont pas des lieux de passage, des espaces de villégiature où l’on se ressource le temps d’un week-end. Ce sont des lieux de vie, où des générations entières grandissent, travaillent, et façonnent l’avenir.
Si une grande partie d’entre nous hésite à revenir sur ces terres qui nous ont vus grandir, c’est aussi pour des raisons économiques. C’est un fait : les emplois qualifiés sont plus concentrés dans les espaces urbains (Roullier, 2011). Mais nos campagnes ne sont pas condamnées à l’inertie.
Une réappropriation politique et culturelle
Comme le rappelle la sociologue et philosophe Dominique Méda : « Si on veut changer le monde, il faut faire de la politique. »
La gauche a un rôle majeur à jouer dans les problématiques rurales. Le vote RN, aux causes multiples et complexes, s’est installé dans une partie de l’électorat rural, mais cette situation n’a rien d’une fatalité. Face à un flot incessant de nouvelles toujours plus abracadabrantesques, la gauche ne doit pas se résigner.
Pour reconquérir politiquement nos campagnes, il est essentiel d’intégrer les inégalités territoriales aux luttes intersectionnelles. Cela signifie aussi ne plus avoir peur de revendiquer nos langues régionales et nos traditions locales, longtemps invisibilisées. Trop longtemps, notre ruralité a été définie par d’autres. Il est temps de reprendre la main sur notre propre récit.
Ne tombons pas dans l’écueil de l’anti-citadisme : la France est riche de ses territoires, qu’ils soient ruraux ou urbains. Leur complémentarité est un maillage essentiel de notre histoire et de notre avenir.