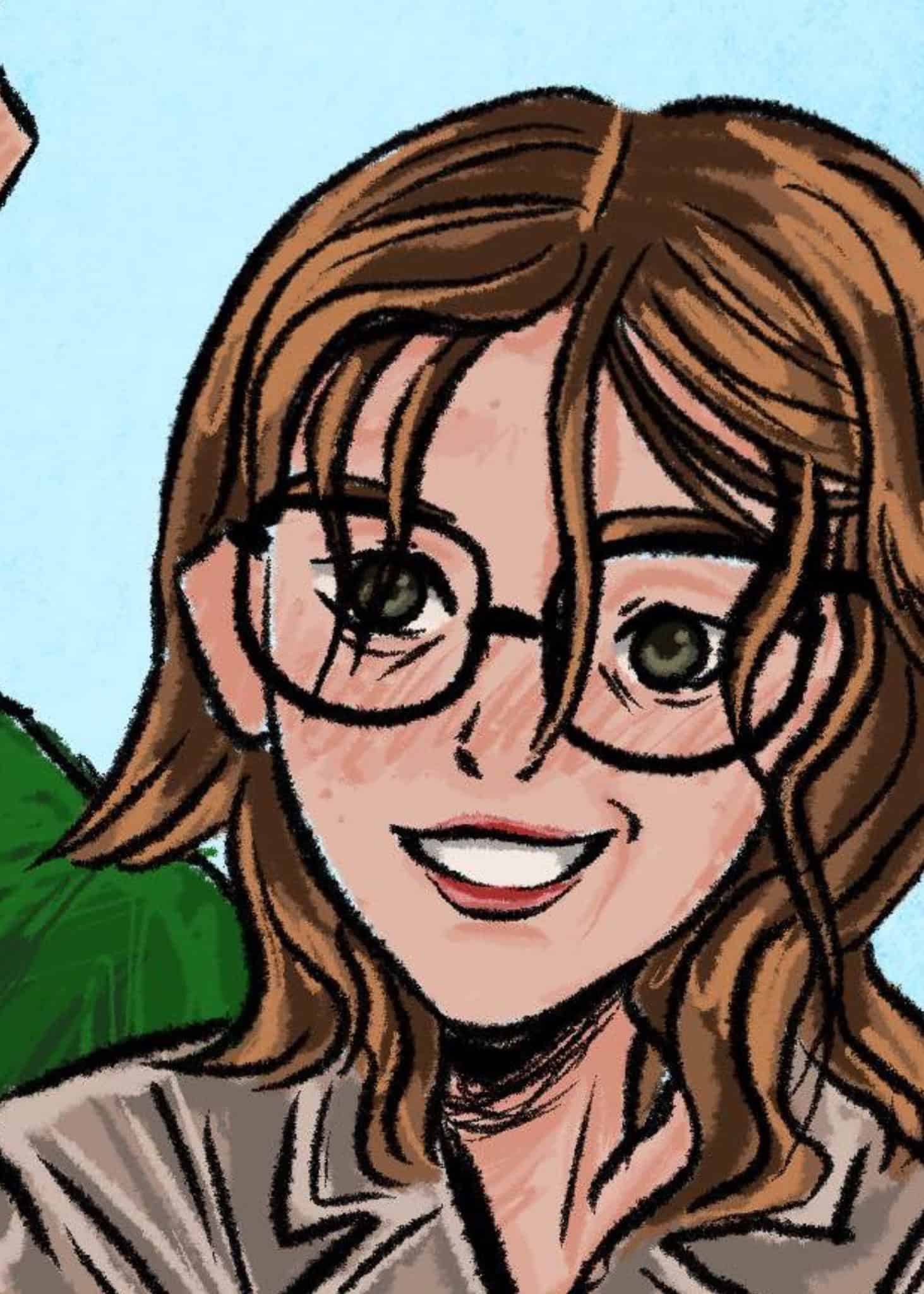Léo Rosell est agrégé d’histoire et enseignant en science politique à l’université Paris-Dauphine PSL. A l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, il a publié le livre « La Sécu, une ambition perdue ? De la solidarité à la rentabilité » aux éditions JC Lattès.
Gavroche : Tout d’abord, est-ce que vous pouvez revenir sur le contexte de la création de la Sécurité sociale en 1945 ?
Léo Rosell : Il faut rappeler que tout ne se crée pas en 1945. Certes, on fête actuellement les 80 ans de l’institution, en retenant la date du 4 octobre 1945, qui est la date de l’ordonnance qui porte création de la Sécurité sociale, mais il faut rappeler quand même que cette réforme-là s’inscrit dans le temps long. On peut remonter au moins à la Révolution française pour voir apparaître le principe selon lequel les secours publics sont une dette sacrée de la nation, et donc l’idée d’une laïcisation de la charité religieuse, portée par les Robespierristes. Justement, au moment de la chute de Robespierre dans le Thermidor, toutes les expérimentations qui avaient été mises en place en termes de bienfaisance nationale, comme on disait à l’époque, disparaissent progressivement. S’ouvre alors un XIXe siècle au cours duquel l’État refuse d’intervenir plus directement dans les questions économiques et sociales.
Le XIXe siècle est marqué par le développement de deux traditions politiques, philosophiques : une tradition républicaine qui revendique une protection sociale universelle reposant sur la solidarité nationale et qui se veut héritière de la Révolution française et une deuxième tradition, qu’on peut dire ouvriériste, dans le sens où elle naît dans le monde du travail. Celle-ci s’appuie sur les caisses de secours mutuels qui sont une forme de solidarité professionnelle et qui sont en même temps des caisses de résistance au patronat et à l’État, dans la mesure où elles sont clandestines.
A la fin du siècle, à partir surtout des années 1880, des initiatives patronales vont, dans le cadre du paternalisme patronal, créer des caisses de retraite. On pourrait penser que c’est par humanisme, mais c’est surtout un moyen de fixer la main d’œuvre car à ce moment-là, la main d’œuvre ouvrière est très mobile. Les ouvriers vont d’une usine à l’autre quand on leur propose un salaire supérieur. Ces caisses de retraites sont donc un outil trouvé par les patrons pour fixer cette main d’œuvre. Concrètement, il faut passer 12 ans dans l’usine pour avoir droit à une retraite.
Dans les années 1890, apparaît une philosophie très importante, le solidarisme, inspiré de l’œuvre de Léon Bourgeois. Ce solidarisme postule le fait que, étant donné que les individus ne peuvent être considérés comme les seuls responsables de leur situation socio-économique, il faut que la société s’organise autour de la solidarité.
Cette philosophie influence la naissance de l’État social. Elle va beaucoup inspirer ce qu’on appelle les réformateurs sociaux et est à l’origine des premières lois de protection sociale : sur les accidents du travail en 1898, celle sur les retraites ouvrières et paysannes en 1910, ou encore sur les assurances sociales qui naissent entre 1928 et 1930.
Tout cela montre bien qu’avant 1945, il y a déjà des origines. Il y a déjà des législations héritées. Ce qui est intéressant, c’est de voir qu’elles sont très imparfaites. Elles sont dénoncées, notamment dans le mouvement ouvrier, par la CGT qui critique ces « retraites pour les morts ». L’espérance de vie des ouvriers à l’époque est de 48 ans et demi, or la retraite est à partir de 65 ans. On observe clairement la limite, même si certains, comme Jaurès, y voient une première pierre sur laquelle bâtir la République sociale.
De plus, cette ancienne législation est inefficace. Pourquoi ? Parce qu’elle repose sur une multiplicité de caisses dans les anciennes assurances sociales : plus de 1 000 caisses d’origine patronale, départementale, confessionnelle, parfois syndicale ou souvent mutualiste. C’est un système très inefficace, très inégal en fonction des caisses, et ce bilan critique est à l’origine d’une sorte de consensus, au sein de la Résistance, sur la nécessité de réformer tout ce système.
Cela se traduit, dans le programme du Conseil national de la Résistance (CNR), adopté le 15 mars 1944, à un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à l’ensemble des citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas, ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État. Le problème du programme du CNR, c’est qu’il doit être accepté par l’ensemble des tendances, donc des communistes aux gaullistes, en passant par les socialistes, les radicaux, les démocrates chrétiens, et même certains royalistes qui étaient opposés à la Collaboration. Or il reste de nombreux débats à trancher comme la question du financement ou la gestion des caisses.
Déjà en 1945, de nombreux pays ont déjà mis en place des systèmes de protection sociale. Pourquoi la France ne le fait que maintenant ?
En effet, il y a d’autres pays qui ont développé des systèmes de protection sociale, notamment d’assurance sociale auparavant. On pense évidemment au système du chancelier Bismarck dans les années 1880 en Allemagne, qui va développer ce système d’assurance sociale. Il s’agit d’un système obligatoire pour les salariés, financé par la cotisation et avec une gestion paritaire, dans le sens où ce sont les patrons et les syndicats de salariés qui gèrent ce système d’assurance sociale. Là encore, on pourrait penser que c’est pour protéger la population, que c’est humaniste, etc. Mais l’objectif premier de Bismarck, et je renvoie à tous les travaux qui ont été faits sur l’Etat social allemand, notamment par Sandrine Kott, est de freiner la montée du socialisme en Allemagne.
Cela interpelle le mouvement ouvrier international, qui va reprendre cette idée d’assurance sociale, mais avec l’idée qu’elles doivent être gérées par les intéressés eux-mêmes, par les travailleurs eux-mêmes. D’ailleurs, dans le programme du Parti Ouvrier Français de Jules Guesde et de Paul Lafargue, en 1882, on retrouve un système selon lequel la société doit prendre en charge notamment les invalides du travail et les vieux travailleurs, et avec des caisses gérées par les intéressés eux-mêmes.
On peut penser à d’autres exemples d’ailleurs, en Tchécoslovaquie, il y a un système assez avancé pour l’époque, et en Grande-Bretagne, il y a le fameux rapport Beveridge de 1942, qui prévoit un système national de santé publique qui repose sur une gestion étatique et sur un financement par l’impôt.
Je parlais tout à l’heure de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes de 1910. En fait, c’est le résultat d’un très long processus parlementaire. Dès la fin des années 1870, surtout au début des années 1880, il y a des projets, des propositions, notamment de Martin Nadaud, qui propose déjà un système de retraite, mais cela prend énormément de temps. La lenteur du processus législatif et les oppositions rencontrées se manifestent aussi par rapport à la loi sur les assurances sociales, votée en 1928-1930, mais après une proposition de 1919, et là aussi, elle est très en deçà des ambitions initiales. Tout cela permet de comprendre que le chemin a été long en France vers la mise en œuvre du fameux régime général de la sécurité sociale, né en 1945.
En réaction au mouvement « I don’t wanna be French » sur Tiktok, de nombreux jeunes Français se sont filmés, carte vitale en main. Pourquoi sommes-nous si fiers de notre système de sécurité sociale ? Quelle est sa particularité par rapport aux autres pays ?
En effet, la Sécurité sociale est un élément de fierté nationale. C’est un trésor national parce qu’elle appartient à l’ensemble des Françaises et des Français. Les enquêtes d’opinion montrent un très fort attachement : 88% de la population française déclare être très fortement attachée à la Sécurité sociale. Le système de protection sociale français est l’un des plus protecteurs au monde, si ce n’est le plus protecteur, si l’on regarde le reste à charge par exemple. Il a démontré son efficacité et son caractère juste socialement au moment de la crise financière de 2008, plus récemment au moment de la pandémie de Covid-19 et d’ailleurs si l’on compare notamment aux systèmes libéraux ou étatiques tant vantés par les pourfendeurs du modèle social français, on voit qu’il a été beaucoup plus efficace qu’aux États-Unis, par exemple.
Quand vous allez à l’hôpital en France, on commence par vous demander votre carte vitale alors qu’aux États-Unis on vous demande votre carte bleue. Cela montre que notre système français repose avant tout sur la solidarité nationale. Ce n’est pas un système aussi ouvert au marché qu’ailleurs. Si l’on regarde les dépenses de santé, les États-Unis dépensent 17% de leur PIB en dépenses de santé alors que la France, 12%. De ce point de vue là, c’est un modèle plus juste, plus solidaire et aussi plus efficace.
Dans la conclusion de votre livre, vous appelez les citoyens à repolitiser la sécurité sociale. Comment est-ce qu’on pourrait concrètement repolitiser la sécurité sociale ?
Cela passe d’abord par le fait de rappeler que l’histoire de la sécurité sociale est avant tout une histoire politique. Elle n’est pas tombée du ciel, et c’est pour ça qu’il faut s’attaquer collectivement à ce « trou de mémoire ». C’est une histoire faite d’espoirs, de débats, de revendications, de conflits, mais aussi de compromis et notamment le moment 1945, très original. La Sécurité sociale est née d’une rencontre inédite entre, d’une part, une haute fonction publique modernisatrice souvent passée par la Résistance, très attachée à une conception émancipatrice de l’État social, et d’autre part, un mouvement ouvrier très puissant au lendemain de la guerre, une CGT qui revendique 5 millions d’adhérents, et qui va conquérir une position centrale dans la démocratie sociale.
Initialement, le régime général de la sécurité sociale est géré par les intéressés eux-mêmes c’est-à-dire que les conseils d’administration des caisses sont composés à 75% de représentants des salariés, à travers leurs syndicats, et 25% de patrons. À partir de 1947, ces fameux conseils d’administration sont élus à travers des élections sociales. Et la division syndicale fait que la CGT, alors majoritaire, va se retrouver progressivement marginalisée par l’alliance des autres centrales syndicales et aussi d’un patronat qui peut parfois jouer de cette division syndicale. La gestion ouvrière est fragilisée par la division syndicale. Déjà, à partir de 1947 avec à la fin de l’année la division entre la CGT et Force Ouvrière.
Le fait aussi que la CFTC, le syndicat chrétien, se retrouve renforcé par les élections sociales d’avril 1947 qui est une victoire de son point de vue même s’ils ont 26% seulement des voix et la CGT 60% : cela rééquilibre un peu la représentativité syndicale antérieure et c’est un élément qui va fragiliser la gestion ouvrière et donner davantage de poids au patronat. En 1967, en plus, est instauré le paritarisme. Très concrètement, cela veut dire que désormais les caisses sont gérées à 50-50 par le patronat et les syndicats ouvriers, ce qui donne de facto la majorité au patronat qui peut là encore s’allier avec les syndicats de salariés dont il se sent le plus proche.
Ensuite, c’est plutôt l’État qui a cherché à reprendre le pouvoir sur la Sécurité sociale. Déjà, à partir de 1967, on assiste à une dynamique d’étatisation de la Sécurité sociale. En 1990-1991, la création de la CSG, la contribution sociale généralisée, a un effet politique dans le sens où cela concerne le financement de la Sécurité sociale : le financement par cotisation avait été retenu en 1945 pour garantir une autonomie budgétaire vis-à-vis des arbitrages de l’État. En faisant progresser la part revenant de la fiscalité dans le financement global de la Sécurité sociale, cela va légitimer une intervention plus importante de l’État en la matière.
Ensuite, il y a une autre date très importante, 1996 : les suites du plan Juppé et l’instauration des lois de financement de la sécurité sociale qui sont une reprise en main du financement de la Sécurité sociale par l’État. Chaque année, une loi est votée par le Parlement autour d’un projet proposé par l’exécutif. Et puis progressivement, surtout à partir du début des années 2000, notamment des grandes réformes de 2004, on va rentrer dans une phase de gouvernance étatique inspirée aussi du nouveau management public, avec la définition d’objectifs de dépenses et leur évaluation, de telle sorte que l’on rentre dans une phase encore plus antidémocratique.
Comment expliquez-vous justement cette mutation de la sécurité sociale ?
Le titre du livre interroge une « ambition perdue », car l’ambition initiale était de créer « un ordre social nouveau », selon l’expression de Pierre Laroque, le premier directeur de la Sécurité sociale. Lors d’un discours, Laroque déclare au sujet de la création de la sécurité sociale : « C’est une révolution qu’il faut faire et c’est une révolution que nous ferons ». Aujourd’hui, on aurait du mal à imaginer un haut fonctionnaire tenir un tel discours ! Cette ambition est aussi partagée par Ambroise Croizat, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui met en œuvre la Sécurité sociale. Cet ancien ouvrier métallurgiste avait gravi progressivement les échelons de la CGT et du PCF.
Pierre Laroque et Ambroise Croizat viennent de milieux très différents. Malgré cela, ils ont su travailler ensemble et faire advenir un héritage commun. Ils ont parlé le même langage, celui de l’intérêt général et de la justice sociale. Leur objectif était de mettre les Françaises et les Français à l’abri du besoin et de les libérer de la peur du lendemain. Malheureusement, cette ambition initiale va être peu à peu perdue. On va passer d’une logique de financement des besoins, et de droits sociaux reconnus comme étant universels, à une exigence inverse de réduction des dépenses.
L’équilibre financier de la sécurité sociale repose sur des dépenses et des recettes. Or, en même temps que l’on cherche à réduire les dépenses, on réduit ses recettes. C’est un choix politique, ce que certains appellent une « politique de la caisse vide », à l’origine d’un déficit de financement, le fameux « trou de la sécu ».
Cela illustre bien la dimension politique de la Sécurité sociale. Le discours budgétaire cherche à dépolitiser la Sécurité sociale, faire comme si les réformes libérales étaient nécessaires pour « sauver la Sécu ». En réalité, à chaque fois, ce sont des arbitrages politiques, des décisions politiques. Il n’y a donc pas de fatalité à laisser détruire une institution sociale qui est centrale dans le quotidien des Français, et dans notre pacte social républicain.